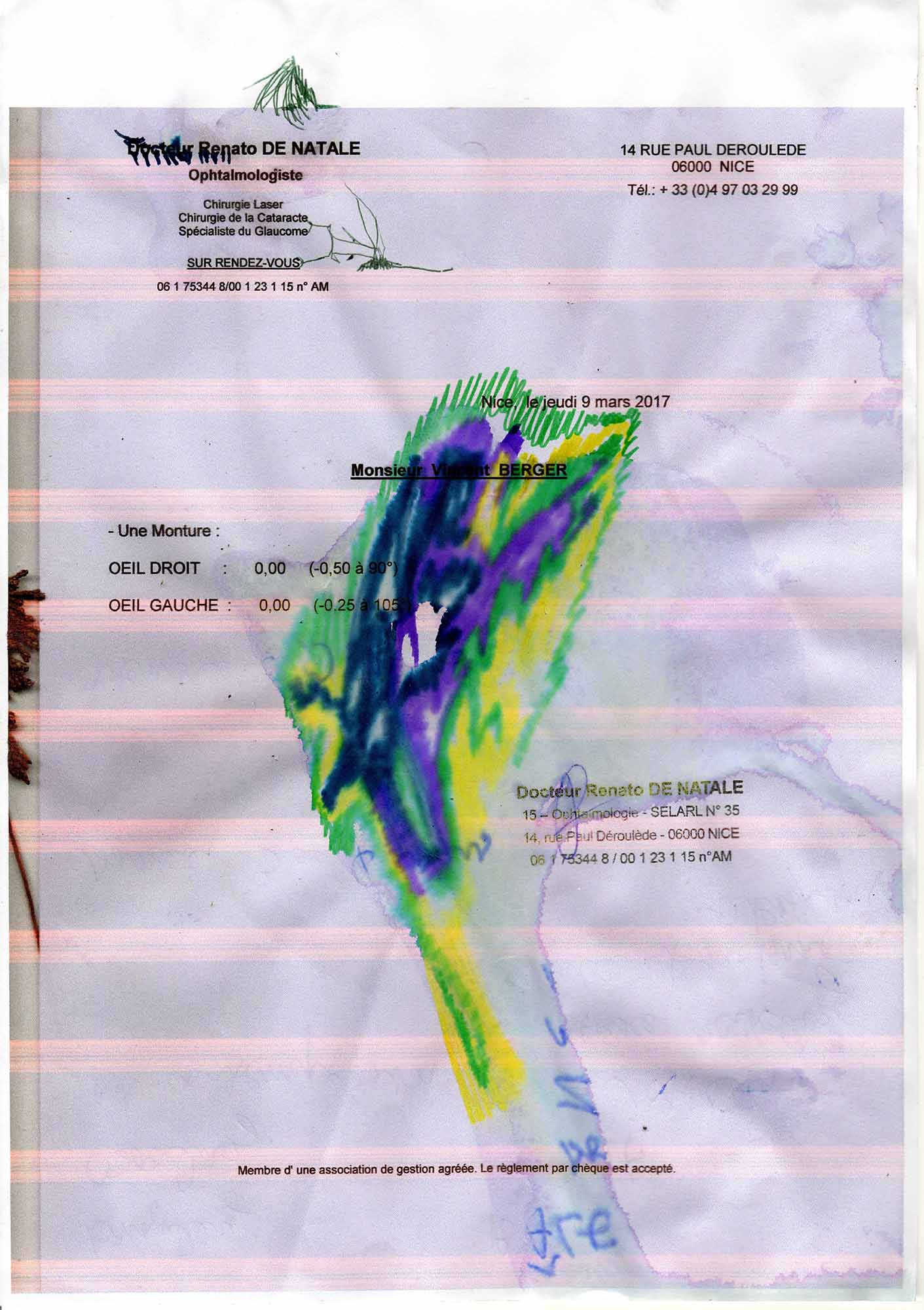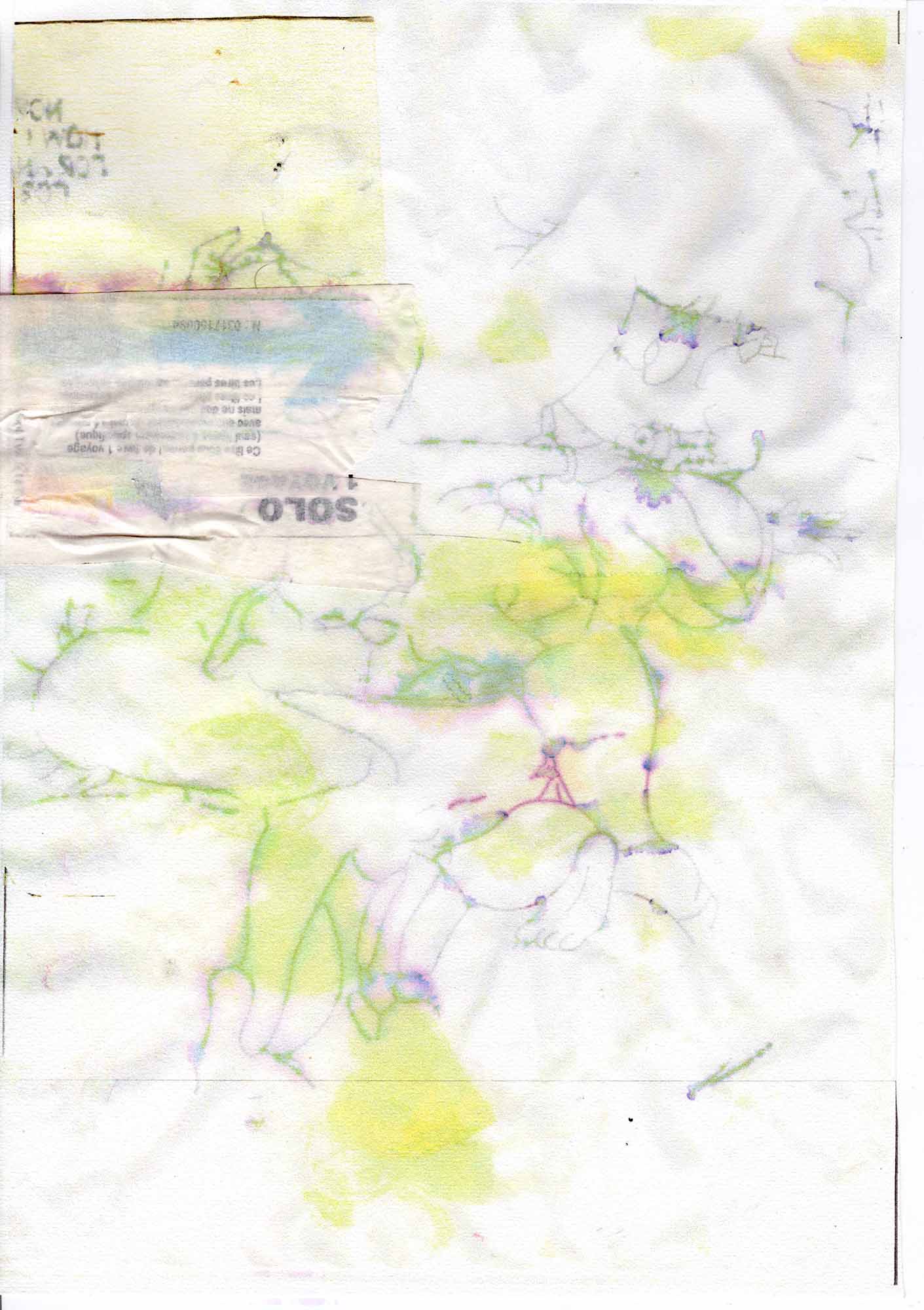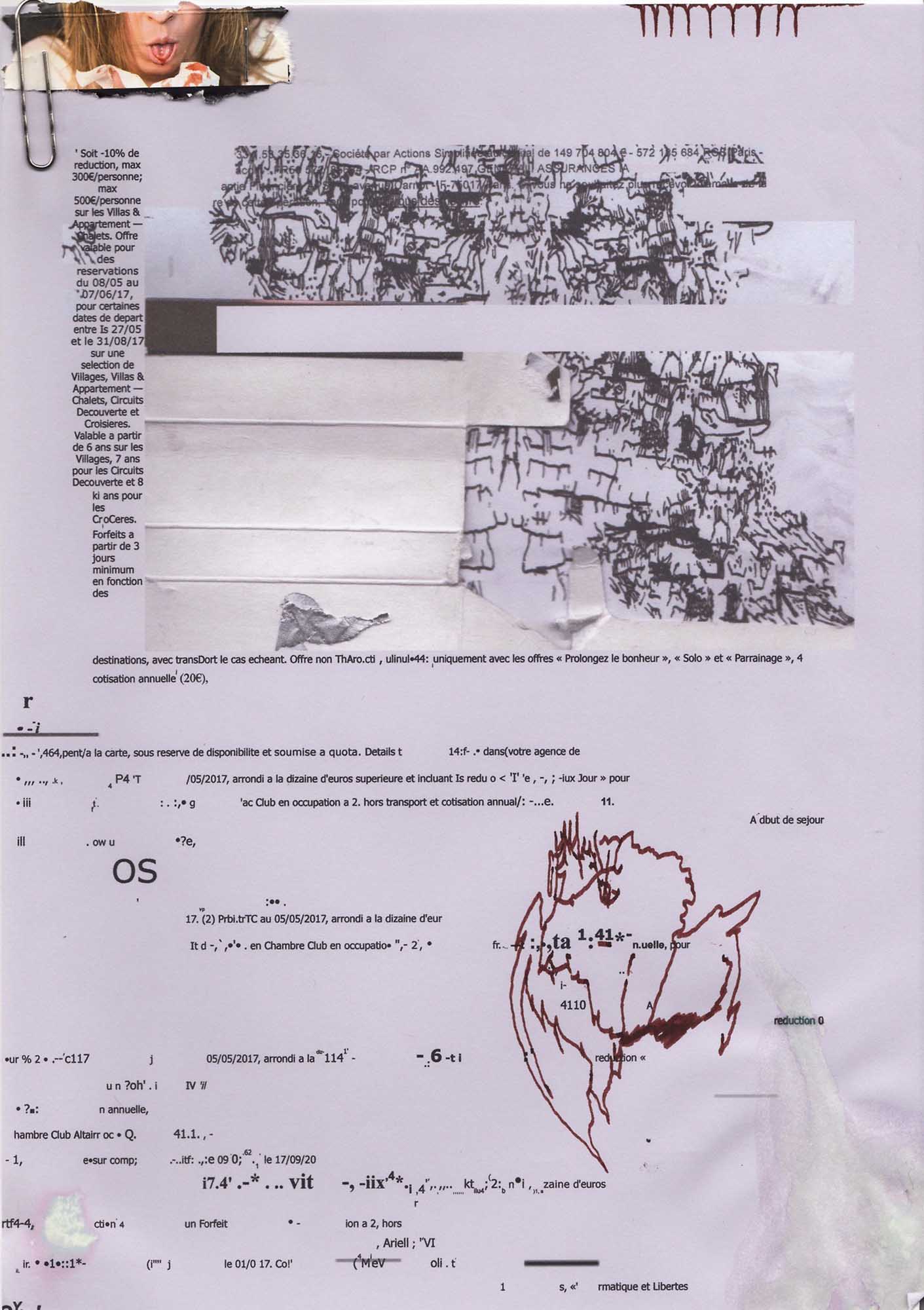Installation sculpturale dessinant au travers d’éléments empruntés à la fois au
mobilier urbain, aux meubles de seconde main, et aux objets de consommation
courante, un territoire de fiction ambigu mais étrangement familier.
Dans les blockbusters américains d’anticipation, l’imaginaire technologique est dominé par une esthétique de la transparence dans laquelle les objets tendent à disparaître au profit d’interfaces translucides ou invisibles. Celle-ci prend racine dans l’utopie fonctionnaliste de l’architecture de verre devenue icône de l’hyper-capitalisme à laquelle répond aujourd’hui l’idéal de la « transparence » démocratique devenu « tyrannie de la transparence » selon les termes d’Emmanuel Alloa et Yves Citton, affectant l’espace public, le cadre de travail, les politiques identitaires, etc.
Dans les usages de la technologie, on observe des processus de prolifération, que cela soit le constant renouvellement des appareils pour s’adapter aux mises à jour ou la production continue de contenus visuels sur les médias sociaux. Ces processus créent des formes de vie et une culture, de laquelle émane des objets et arts spécifiques, dont les qualificatifs seraient plutôt ceux de l’opacité et de l’hypermatérialité.
Le travail de Vincent Burger s’inscrit dans les paradoxes de cette coprésence en portant une attention particulière à l’intersection de ces esthétiques avec les arts vernaculaires existants. Il construit des installations dans lesquelles les objets semblent avoir subi des perturbations de fonctionnalité et des piratages sémantiques. Il utilise des objets de seconde main ou de consommation courante qu’il assemble avec des images, générant des fictions ergonomiques. J’ai été marquée par une série de boites de conserve et de paquets de cigarettes qu’il a recouvert avec un packaging fait à partir d’images de spams, photographies et vidéos virales. Dans une de ses sculptures, ces objets ont été disposés dans un cabinet de pharmacie dont la disposition orthogonale m’a rappelé le design graphique de l’interface Facebook, une apparition troublante témoignant de l’érosion endémique de mes références visuelles diluées dans les spams.
Barbara Sirieix, le 12 juin 2019.